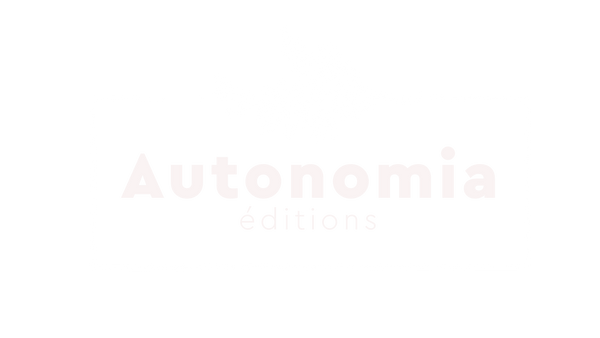En rédigeant L’Encyclopédie des jus santé, j’ai exploré l’ensemble de la littérature scientifique disponible sur le sujet, qui demeure encore très limitée. Les détracteurs des jus, ou ceux qui peinent à comprendre l’intérêt réel des jus, s’appuient sur l’étude suivante pour discréditer leurs bienfaits : Effects of Vegetable and Fruit Juicing on Gut and Oral Microbiome Composition, menée par l’équipe de Maria Luisa Savo Sardaro et parue dans la revue Nutrients en janvier 2025 [1].
J’ai trouvé particulièrement intéressant de prendre cette publication comme exemple, à la fois pour illustrer les biais méthodologiques et interprétatifs que l’on peut rencontrer dans une étude scientifique, et pour rappeler l'intérêt des jus, qui n’est pas d’agir sur le microbiote.
QUE DIT LA SYNTHÈSE ET LA CONCLUSION DE CETTE ÉTUDE ?
Synthèse (extrait) : « Ces dernières années, les cures de jus ont souvent été présentées comme un moyen pratique d’augmenter la consommation de fruits et légumes, avec des régimes exclusivement à base de jus promus pour « nettoyer » le système digestif et améliorer la santé globale. Cependant, l’extraction de jus élimine la majeure partie des fibres insolubles, ce qui peut réduire les bénéfices des fruits et légumes entiers. Une consommation plus faible de fibres peut modifier le microbiote, affectant ainsi le métabolisme, l’immunité et la santé mentale, bien que les effets spécifiques du jus sur le microbiote soient encore peu connus. Cette étude vise à combler cette lacune en explorant comment la consommation de jus influence la composition du microbiote intestinal et buccal dans le cadre d’une étude d’intervention. »
Conclusion : « Cette étude met en lumière les impacts sanitaires critiques des régimes alimentaires d’intervention, en particulier d’un régime exclusivement composé de jus. Les résultats ont montré des modifications du microbiote oral, notamment au niveau des familles de bactéries pro-inflammatoires. Le microbiote intestinal a également présenté une augmentation de certains taxons associés à la perméabilité intestinale, à l’inflammation et au déclin cognitif. Ces observations suggèrent qu’une consommation de jus à court terme pourrait avoir un effet négatif sur le microbiote, probablement en raison de la réduction de fibres et de la teneur plus élevée en sucre et en glucides, ce qui souligne la nécessité de recherches supplémentaires sur les interactions entre alimentation, microbiote et maladies, d’autant que les jus sont souvent considérés comme un substitut aux fruits dans l’alimentation quotidienne des enfants. »
En résumé, l’extrait et la conclusion soulignent deux points essentiels :
- les fibres jouent un rôle crucial pour la santé du microbiote intestinal, or les jus sont dépourvus de fibres insolubles ;
- les personnes suivant un régime exclusivement composé de jus présentaient une altération de leur microbiote intestinal, avec une augmentation des bactéries pro-inflammatoires.
Mais en analysant l’étude en détail, on constate que ces résumés sont exagérés, trompeurs, et surtout, que l’étude comporte plusieurs biais importants.
LES JUS N’ONT PAS VOCATION PARTICULIÈRE À AMÉLIORER LE MICROBIOTE INTESTINAL
La première chose à savoir c’est que les jus de légumes n’ont pas pour objectif principal d’améliorer le microbiote intestinal. Dans mon ouvrage, je rappelle que ce sont le rôle des fibres qui sont indispensables à la santé. Les jus doivent donc être considérés comme un complément à une alimentation riche en fibres, et non comme un substitut.
Leurs intérêts premiers sont de combler les carences nutritionnelles, de recharger l’organisme en enzymes et de l’inonder de composés phytochimiques aux multiples vertus : antioxydantes, détoxifiantes, drainantes, dépuratives, antivirales, antibactériennes, antifongiques, diurétiques, laxatives, émollientes, astringentes, expectorantes, mucolytiques, cholérétiques, cholagogues, anticancéreuses, etc. Ainsi, cela permet de pallier rapidement aux carences courantes de notre civilisation et d’aider les fonctions et les systèmes du corps en lui offrant un concentré de micronutriments, d’enzymes et de composés phytochimiques.
Au-delà de leur richesse nutritionnelle et de leurs composés phytochimiques thérapeutiques, les jus contribuent également à alcaliniser l’organisme, à limiter les dommages liés à l’oxydation, à hydrater en profondeur, à réduire l’inflammation, à revitaliser et à favoriser l’élimination des déchets.
En somme, il serait donc réducteur de juger leur intérêt sous le seul angle du microbiote. Ils offrent de nombreux autres bienfaits dont il serait dommage de se priver. Comme je le dis dans mon livre :
« Rejeter les jus sous prétexte qu’ils ne contiennent pas de fibres reviendrait à dire que boire de l’eau est inutile parce qu’elle n’en contient pas non plus. Ce raisonnement simpliste ne tient pas compte des multiples bienfaits que les jus de légumes peuvent offrir en termes d’apport en nutriments, tout en coexistant avec une consommation suffisante d’aliments riches en fibres. »
Certes, dans l’absolu il est toujours préférable de consommer des aliments entiers, et il est vrai que les jus n’existaient pas dans le contexte primitif des chasseurs-cueilleurs. Mais il ne faut pas oublier de nous replacer dans le contexte d’aujourd’hui : nous n’avons plus accès à la même qualité nutritionnelle que nos ancêtres car nos aliments sont souvent moins frais car importés, nos aliments sont stockés avant consommation, et surtout nos sols ne sont plus vivants. Notre environnement est différent et notre mode de vie moderne puise plus rapidement dans nos réserves. Dans ce contexte, les jus représentent une solution « non naturelle » pour compenser les déséquilibres d’un environnement devenu « non naturel ».
UNE ÉTUDE D’UNE DURÉE DE 3 JOURS SUR SEULEMENT 14 PARTICIPANTS….
Pour apprécier la portée et la fiabilité de cette étude, il convient de rappeler qu’elle n’a duré que trois jours et qu’elle a été menée sur un échantillon très restreint de 14 participants (7 femmes et 7 hommes), répartis en trois groupes :
- groupe 1 : une « cure de jus pressés à froid » fournissant 800–900 kcal, suivi par 2 hommes et 3 femmes ;
- groupe 2 : un régime de « jus pressés à froid + alimentation habituelle ad libitum », suivi par 2 hommes et 2 femmes ;
- groupe 3 : un régime de « végétaux composé d’aliments entiers » fournissant 800–900 kcal, suivi par 3 hommes et 2 femmes.
Au final, seules 9 personnes ont réellement été étudiées dans le cadre de la consommation de jus !
Des échantillons de microbiote (selles, salive et écouvillons de l’intérieur de la joue) ont été collectés :
- au départ,
- après un régime d’élimination pré-intervention,
- immédiatement après le régime d'intervention,
- 14 jours après celui-ci.
Tous les participants ont commencé l’étude en faisant 3 jours de « régime d’élimination pré-intervention », comprenant des fruits et légumes frais biologiques, des céréales complètes sans gluten, des œufs et 8 verres d’eau par jour. Ce régime leur imposait d’éviter ou de supprimer l’alcool, la caféine, le sucre, les aliments transformés, les produits laitiers, la viande rouge ainsi que le gluten.
AUCUN GROUPE DE PARTICIPANTS CONSOMMANT DES JUS EN COMPLÉMENT D’UN RÉGIME VÉGÉTAL RICHE EN FIBRES
Ce qui me frappe, c’est que les chercheurs n’ont pas inclus de groupe de participants consommant des jus pressés à froid en complément d’un régime végétal basé sur des aliments entiers. En effet, les deux groupes étudiés recevant des jus suivaient soit une cure exclusivement composée de jus, donc sans fibres, soit une alimentation conventionnelle sans restriction, donc très pauvre en fibres. Or, ce sont précisément les fibres qui influencent et modulent le microbiote intestinal. Il est donc parfaitement logique que les résultats ne peuvent pas été positifs sur ce plan. Un groupe 4 « jus + régime de végétaux composé d'aliments entiers » aurait été bienvenu.
J’irais même plus loin : j’ai toujours défendu les bienfaits d’un régime de type méditerranéen, privilégiant la consommation de fruits et légumes entiers, frais et biologiques, l’apport d’œufs pour leur qualité en matières grasses, ainsi qu’une réduction de la consommation de viande et l’éviction du gluten, de la caféine, de l’alcool et des aliments transformés.
Mes recommandations se rapprochent fortement du « régime d’élimination » appliqué avant l’intervention. L’étude a d’ailleurs précisé que ce régime avait des effets globalement légèrement bénéfiques sur le microbiote intestinal et, dans une certaine mesure, sur le microbiote oral :
-
Microbiote oral : bien que l’on observe une augmentation de Proteobacteria (associée à l’inflammation), les chercheurs ont aussi relevé une hausse de bactéries considérées comme normales et potentiellement protectrices (Neisseria sp., Haemophilus parainfluenzae), ainsi qu’une diminution de Lachnospiraceae sp. liée aux troubles cognitifs, ce qui pourrait être bénéfique.
-
Microbiote intestinal : les changements observés allaient dans le sens d’un meilleur équilibre, avec :
- augmentation de Faecalibacterium prausnitzii (productrice de butyrate, protecteur du côlon et anti-inflammatoire) ;
- hausse de bactéries bénéfiques de la famille Lachnospiraceae (Blautia, Coprococcus, Dorea, Roseburia) impliquées dans la régulation de l’inflammation, la protection cardiovasculaire, la maturation immunitaire et la production d’antibiotiques naturels ;
- présence accrue de Bacteroides uniformis (améliore la digestion des fibres et l’équilibre immunitaire) et de Bifidobacterium spp. (probiotique bien connu) ;
- diminution de bactéries potentiellement pathogènes comme Bacteroides fragilis, Bacteroides caccae et Enterococcus spp.
Il est intéressant de noter que même le « régime d’élimination » entraîne lui aussi une légère augmentation des bactéries pro-inflammatoires dans le microbiote buccal, tout comme les régimes à base de jus. Cela ne doit toutefois pas être interprété comme un effet négatif : la présence de certaines familles de bactéries dans la bouche peut être transitoire et simplement liée au processus digestif, de la même façon que l’inflammation se manifeste temporairement après une activité physique.
DES CHANGEMENTS DE MICROBIOTE RELATIVEMENT FAIBLES EN AMPLITUDE ET DIFFICILEMENT INTERPRÉTABLES
Premièrement, il convient de préciser que les changements observés concernaient surtout le microbiote buccal, beaucoup plus sensible aux variations alimentaires. Le microbiome salivaire réagit rapidement et de façon marquée, ce qui est logique puisqu’il joue un rôle clé dans la pré-digestion. En effet, les chercheurs confirment que le microbiote intestinal a très peu évolué en réponse aux différents régimes.
Deuxièmement, les auteurs soulignent que, malgré les préoccupations potentielles, les changements observés dans les microbiotes oral et intestinal restaient globalement faibles.
Troisièmement, rappelons-nous que l’étude détaille la teneur des légères variations à plusieurs moments : (i) au départ, (ii) après un régime d’élimination pré-intervention, (iii) immédiatement après l’intervention à base de jus, et (iv) 14 jours après celle-ci. Si les groupes suivant un régime à base de jus présentent une légère hausse de bactéries pro-inflammatoires juste après les 3 jours de régime, il est important de souligner que, 14 jours plus tard, on observe chez le régime « 100% jus » une hausse des Firmicutes et des Bacteroidetes, accompagnée d’une nette diminution des Proteobacteria par rapport aux valeurs de référence.

Les Proteobacteria sont connues pour leur caractère pro-inflammatoire car elles possèdent dans leur membrane externe des lipopolysaccharides (LPS), aussi appelés endotoxines. Les chercheurs soulignent que l’augmentation des Proteobacteria observée dans le microbiote pourrait s’expliquer par leur aptitude à consommer rapidement les sucres simples et à se multiplier à grande vitesse. Il est important de préciser qu’un microbiote sain se définit par une grande diversité et un rapport équilibré entre Firmicutes et Bacteroidetes. L’augmentation simultanée de ces deux familles, associée à la baisse des Proteobacteria, constitue donc un indicateur très positif. Ainsi, l’impact d’une cure de jus ne devrait pas être évalué uniquement immédiatement après celle-ci, mais aussi à la lumière des bénéfices constatés à moyen terme, un peu comme les effets positifs du jeûne, qui se révèlent principalement au moment de la réalimentation plutôt que durant la période de privation.
Quatrièmement, la rédaction de l’étude manque de clarté et de transparence, ce qui rend la vérification difficile. Dans la section « Résultats », les chercheurs se limitent à présenter les variations des grandes phyla bactériennes, sans préciser les espèces qui les composent. Or, au sein d’un même phylum (embranchement), certaines familles et espèces peuvent avoir des effets bénéfiques et d’autres des effets délétères selon le contexte et l’équilibre global du microbiote. Ce n’est que dans la partie « Discussion » que sont mentionnées 4 familles de bactéries associées potentiellement à de l'hyper-perméabilité et des troubles cognitifs. Mais la rédaction ne précise pas si la présence de ces familles sont observés juste après le régime d'intervention ou 14 jours après. L’ensemble reste flou.
Cinquièmement, ces résultats contredisent ceux de l’étude de Henning et al. (2017), qui a observé une diminution des Proteobacteria dans les selles et plusieurs bienfaits [2] :
« Vingt adultes en bonne santé ont consommé uniquement des jus de légumes et de fruits pendant 3 jours, suivis de 14 jours de régime alimentaire habituel. Le quatrième jour, nous avons observé une diminution significative du poids et de l’indice de masse corporelle (p = 2,0E-05), diminution qui s’est maintenue jusqu’au jour 17 (p = 3,0E-04). Ce même jour, la proportion des phylums Firmicutes et Proteobacteria dans les selles avait significativement diminué, tandis que les Bacteroidetes et les Cyanobacteria avaient augmenté par rapport aux valeurs initiales, avec un retour partiel à la normale au jour 17.
Toujours au quatrième jour, l’oxyde nitrique plasmatique et urinaire avait respectivement augmenté de 244 ± 89 % et 450 ± 360 %, tandis que le marqueur urinaire de la peroxydation lipidique, le malondialdéhyde, avait diminué de 32 ± 21 % par rapport au départ. Enfin, le score de bien-être général était amélioré à la fin de l’étude.
En résumé, un régime exclusivement à base de jus pendant 3 jours a modifié le microbiote intestinal, entraînant une perte de poids, une augmentation de l’oxyde nitrique vasodilatateur et une diminution de l’oxydation lipidique. »
Pour terminer, la comparaison des quatre temps de mesure (valeur de départ, pré-intervention, post-intervention et 14 jours après) pour les trois régimes révèle selon les chercheurs une tendance générale du microbiote à revenir vers sa composition initiale. En effet, le microbiote est résilient et a toujours tendance à revenir à sa signature d’origine. Ce qui ne veut pas dire que l'alimentation ne peut pas changer durablement le microbiote. Toutefois, ce n’est qu’en adoptant un régime sur du long terme que l’on peut modifier sa composition de façon durable.
Conclusion : il n’y a donc pas matière à tirer de conclusions, et encore moins alarmistes, à partir de ces données.
AUCUNES PRÉCISIONS SUR LA COMPOSITION DES JUS QUI S’AVÈRENT… TRÈS SUCRÉS
Parler de « jus », sans préciser de quels types de jus il s’agit, n’a pas beaucoup de sens : s’agit-il de jus de fruits, de jus de légumes, de jus pasteurisés ou de jus frais pressés à froid ? Dans mon ouvrage, j’insiste sur le fait que les vrais jus santé devraient être composés principalement de légumes pour leur faible teneur en sucres. En effet, consommer des jus riches en sucres sans les fibres qui les accompagnent naturellement va entraîner des pics de glycémie peu souhaitables et pro-inflammatoires.
Dans mon livre, je précise que j’intègre des fruits et des légumes racines sucrés dans mes recettes pour des raisons gustatives, afin de rendre les jus plus agréables et de faciliter leur adoption au quotidien. Je recommande néanmoins une proportion d’environ 70 % de légumes et 30 % de fruits, même si, selon moi, l’idéal reste les jus composés à 100 % de légumes. Les jus à teneur élevée en sucre devraient être consommés en accompagnement d’un repas riche en fibres et évités lorsqu’on est à jeun.
Dans l’étude en question, les chercheurs soulignent que les régimes à base de jus étaient associés à une augmentation de l’abondance relative de taxons bactériens spécialisés dans le métabolisme des sucres simples. Ainsi, les jus utilisés dans l’étude étaient particulièrement riches en sucres. En effet, il n'est pas caché que le régime exclusivement à base de jus contenait beaucoup plus de sucre (≈ 20,6 g) et de glucides totaux (≈ 38,6 g), comparé au régime mixte jus/fruits/légumes (≈ 13,1 g de sucre et 18,8 g de glucides)... Ce qui suffit déjà à disqualifier cette « cure de jus » comme représentative d’un régime santé.
LES CURES DE JUS SONT : DES SEMI-JEÛNES AVEC TOUTES LES EFFETS QU’ILS INDUISENT
Les cures de jus, consistant à ne consommer que des jus de légumes, ne constituent pas un mode d’alimentation viable sur le long terme. Elles relèvent plutôt d’une technique naturopathique visant à imiter les effets du jeûne, un peu comme les fasting mimicking diets (régimes qui reproduisent les bénéfices du jeûne). Ces cures exclusivement de jus doivent donc rester ponctuelles.
Lorsqu’on fait des jeûnes ou semi-jeûne, on déclenche des processus de « nettoyage » : l’organisme remet en circulation des substances indésirables, ce qui peut provoquer les fameuses crises d’acidose. L’élimination des acides s’accélère, le corps entre dans un état inflammatoire temporaire, et il est parfaitement logique d’observer, dans ce contexte, une augmentation des bactéries pro-inflammatoires. C'est pourquoi, on ne peut pas tirer de conclusions générales à partir de données recueillies sur une courte période.
Prenons un exemple parlant que je cite dans mon livre : en 2024, des chercheurs du Penn State College of Health and Human Development ont étudié l’effet de la restriction calorique sur les télomères, ces marqueurs du vieillissement biologique dont le raccourcissement est lié à l’apparition de maladies liées à l’âge. Les résultats ont été publiés dans la revue Aging Cell [3]. Les observations ont montré une évolution intéressante :
- Première année : les participants en restriction calorique ont perdu du poids et vu leurs télomères se raccourcir plus vite que ceux du groupe témoin ;
- Deuxième année : une fois leur poids stabilisé, la perte de télomères a ralenti chez eux par rapport au groupe témoin ;
- Au bout de deux ans : les deux groupes présentaient des longueurs de télomères statistiquement similaires.
Comme l’a souligné le chercheur Shalev, ces résultats ouvrent davantage de questions qu’ils n’en résolvent. Que se passerait-il si l’étude se poursuivait une année de plus ? Un suivi sur dix ans est d’ailleurs prévu. Cela illustre bien qu’il est risqué de généraliser des résultats obtenus sur une période aussi courte et sur un échantillon limité.
CONCLUSION
Alors, les jus sont-ils vraiment néfastes pour le microbiote ? Cette étude ne permet pas de trancher. La question à se poser est alors : pourquoi le seraient-ils ? Le risque potentiel vient surtout du sucre absorbé sans les fibres, ce qui est pro-inflammatoire, mais cela n'est pas propre aux jus de légumes mais aux boissons sucrées. En revanche, pour les jus de légumes peu sucrés rien n’indique qu’ils posent problème. On peut éventuellement se poser la question en cas d’excès d’oxalates consommés de façon répétée (c'est une question auquel je répondrais dans un autre article). Au contraire, les nombreux composés phytochimiques des fruits et légumes sont connus pour soutenir la santé intestinale. Prenons quelques exemples :
- Les légumes verts apportent de la chlorophylle, une molécule aide à réguler le transit intestinal et à équilibrer le microbiote.
- L'anéthol du fenouil qui aide à réduire les spasmes musculaires et les crampes, notamment dans le tractus gastro-intestinal. La fenchone, présente particulièrement dans les fenouils amers, est responsable des propriétés antispasmodiques de ce légume (contre les maux de ventre et les règles douloureuses). Des études cliniques portant sur le fenouil montrent à ce titre son effet bénéfique sur les coliques du nourrisson et des jeunes enfants.
- Le céleri-branche cru est parmi les légumes qui contiennent le plus de chlorure, un oligo-élément qui contribue à une digestion normale grâce à la production d’acide chlorhydrique dans l’estomac. Le type de sodium qu’il contient affamerait également les agents pathogènes et bactéries indésirables et neutraliserait les toxines dans la sphère intestinale.
- Les épinards contiennent des antinutriments, principalement des acides oxaliques (oxalates) et des acides phytiques (phytates). Ces antinutriments peuvent se lier au calcium, fer, magnésium, zinc et réduire leur biodisponibilité dans le corps. Comme le corps cherche naturellement à éliminer ces antinutriments, les jus à base d’épinards favorisent l’évacuation des selles. Cela vaut ce que ça vaut mais Normal Walker disait que l’acide oxalique est un des éléments importants nécessaires à maintenir le péristaltisme intestinal. Il précise que « l’acide oxalique dans la nourriture cuite ou transformée est définitivement mort, et en tant que tel il est nuisible et destructeur. L’acide oxalique se mélange alors facilement au calcium. Si les deux sont vivants il en résulte une combinaison bénéfique. Le premier aide l’assimilation du second, et en même temps stimule les fonctions péristaltiques du corps. Quand l’acide oxalique devient inerte à cause de la cuisson ou de la transformation, il forme un composé qui s’imbrique avec le calcium, y compris avec le calcium d’autres aliments consommés au cours du même repas, détruisant les valeurs nutritives des deux.»
- Les polyphénols du raisin aident à restaurer et maintenir l’équilibre du microbiote, notamment en augmentant les bonnes bactéries (Bifidobacteria, Akkermansia, Clostridia), essentielles à la santé intestinale, en limitant les effets néfastes des régimes transformés qui perturbent le microbiote, en protégeant l’intestin des effets néfastes de certains composés toxiques, et en aidant à rétablir le microbiote après une prise d’antibiotiques, lesquels fragilisent la flore intestinale
- Le soufre, le chlore et la vitamine U présente dans le jus de chou améliore l’état de l’intestin en renforçant la barrière intestinale : il réduit la destruction des cellules intestinales, augmente la production de mucus protecteur et renforce les jonctions serrées entre les cellules de la paroi intestinale. Dans des études sur des souris, l’analyse du microbiote intestinal a montré une augmentation des bactéries productrices d’acides gras à chaîne courte (AGCC), des composés très bénéfiques pour la santé. Ces AGCC activent le récepteur PPAR-γ, qui inhibe la voie inflammatoire NFκB, réduisant ainsi la production de molécules inflammatoires. De plus, le jus de chou rouge a favorisé un bon équilibre intestinal en augmentant la production d’AGCC et en réduisant la dégradation de certains acides aminés, ce qui est bénéfique pour la santé du côlon.
- Les composés anthraquinoniques de la rhubarbe a des effets laxatifs puissants : ils stimulent les contractions intestinales, activent certains nerfs et rendent les muscles de l’intestin plus réactifs, favorisant ainsi le transit. Ses tanins, à l’inverse, ont une action antidiarrhéique. La rhubarbe contribue aussi à la santé intestinale en rééquilibrant le microbiote, en renforçant la barrière intestinale, en régulant l’inflammation et en stimulant la production de mucus protecteur.
- Les caroténoïdes des carottes ont des effets antibactériens, mais aussi un rôle prébiotique, c'est-à-dire qu’ils pourraient favoriser le développement de bonnes bactéries bénéfiques pour la santé.
Paradoxalement, les chercheurs de cette étude rappellent dans l'introduction que la consommation de jus présente effectivement des effets positifs à la lumière des données disponibles. Ils précisent simplement que l’extraction du jus peut faire perdre une partie des atouts des fruits et légumes entiers parce qu’elle réduit leur teneur en fibres. C’est pourquoi, il est nécessaire d’intégrer les jus en compléments d’une alimentation riche en fibres, ce qui n’a malheureusement pas été étudié. Enfin, ils insistent bien sur la composition nutritionnelle des jus, notamment leur teneur en sucres, qui peut fortement varier et ce point est très important :
« Des études ont démontré que les jus constituent un moyen efficace pour bénéficier des apports nutritionnels des fruits et légumes, en améliorant notamment les niveaux de bêta-carotène, de vitamine C et de vitamine E [4]. Par exemple, des revues récentes de la littérature ont conclu que les jus de fruits et légumes à 100 % semblent avoir un effet bénéfique ou neutre sur la santé [5] et présentent même des effets cardioprotecteurs, notamment en réduisant la pression artérielle et en améliorant le profil lipidique [6]. Néanmoins, le processus d’extraction propre au pressage de jus peut réduire certains bénéfices pour la santé des fruits et légumes entiers, en modifiant des propriétés telles que la teneur en fibres [7]. Ces modifications peuvent influencer la manière dont les fruits et légumes interagissent avec la santé par divers mécanismes, y compris via le microbiote intestinal. Cependant, si plusieurs études ont exploré le lien entre consommation de fruits et légumes et microbiote intestinal, peu se sont intéressées spécifiquement aux jus [8,9,10], qui représentent un contexte particulier puisqu’une grande partie des fibres insolubles en est retirée [8]. Par ailleurs, selon les fruits et légumes utilisés, la teneur en sucre, en glucides totaux et la charge glycémique des jus peuvent varier [11]. »
Pour obtenir des données réellement pertinentes, il aurait été nécessaire de :
- mener l’étude sur une cohorte plus large ;
- prolonger l’observation sur plusieurs années ;
- inclure un groupe consommant des jus en complément d’une alimentation majoritairement végétale, riche en fibres et composée d’aliments entiers ;
- privilégier des jus exclusivement composés de légumes, ou contenant au moins 70 % de légumes ;
- élargir l’analyse des bienfaits au-delà du seul microbiote intestinal.
Mon approche se veut scientifique. Mais lorsqu’il n’existe pas de données « scientifiques », j’encourage toujours à expérimenter par soi-même et à tirer ses propres conclusions. Par ailleurs, il est important de rappeler que la science elle-même n’est pas exempte de limites. John P. A. Ioannidis, directeur du Lancet, a publié en 2005 un article devenu célèbre : Why Most Published Research Findings Are False. Il y démontre que la majorité, si ce n'est la quasi-totalité des études scientifiques, sont peu fiables, notamment en raison de biais méthodologiques, de la faiblesse des échantillons ou de la souplesse dans la définition des critères de résultat.
Se forger sa propre opinion passe aussi par l’apprentissage de la physiologie, afin de pouvoir formuler des interprétations plus fines et plus justes. Cela implique également de recueillir les témoignages de votre entourage et de cultiver votre esprit critique, pour ne pas tomber dans le piège des conclusions simplistes et parfois trompeuses véhiculées par des intermédiaires. Tester c'est l'adopter, puisque pour ma part, j’ai résolu une dysbiose intestinale, avec ballonnements et ventre gonflé, entre 2017 et 2018, grâce à l’adoption d’un régime végétal cru associé à la consommation quotidienne de jus de légumes.
Source :
[1] https://www.mdpi.com/2072-6643/17/3/458
[2] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28526852/
[3] https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/acel.14149
[4] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15190044/
[6] https://www.mdpi.com/1422-0067/18/3/555
[7] https://www.mdpi.com/2072-6643/13/6/1815
[8] https://www.nature.com/articles/s41598-017-02200-6
[9] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002916523125172
[10] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30319847/
[11] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1028415X.2021.2020403